De Bretagne en Flandres par
Jean-François Gautier
pour Kistinenn
BRULELOU=BRITO?
Pieter
Obbema (1930-2015)
fut conservateur des manuscrits occidentaux à la Bibliothèque
Universitaire de
Leyde (Hollande). En 1980, paraît une étude intitulée «
Johannes Brito alias Brulelou »,
dans laquelle il établit que Brulelou est la véritable identité de
Brito.
Sa
démonstration se base sur une analyse minutieuse
d'un manuscrit (BPL 138) que possède la Bibliothèque Universitairede
Leyde. Il
s'agit d'un livre de cent soixante-sept feuillets, recouvert d'un
parchemin
rigide (« cornu » disent les Hollandais), écrit à la main en cursive
française
et contenant trois œuvres en latin : les Disticha Catonis (Caton
234-149
avant
Jésus-Christ), l’Ecloga
de Theodolus et Les
remèdes à l’amour
d’Ovide (43
avant
Jésus-Christ-18 après Jésus-Christ). Au xve siècle,
ces textes font partie du bagage de tout étudiant.
Intérêt
majeur de ce manuscrit : il est daté, localisé
et signé à deux reprises.
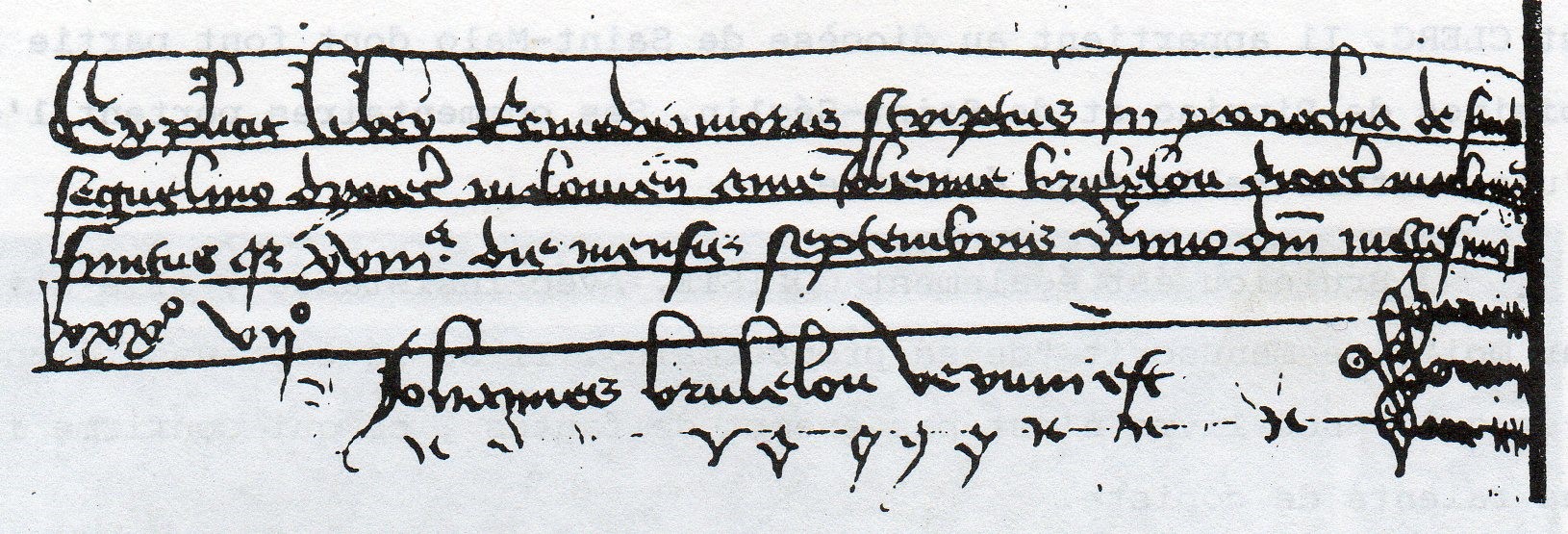
©
Leiden
Universiteitsbibliotheek
À la
fin du livre Les remèdes à l'amour,
on peut traduire ainsi :« Écrit en la paroisse de Saint-Séglin, diocèse
de
Saint-Malo, par moi, Jean Brulelou, du diocèse de Saint-Malo, et achevé
le
dix-huitième jour du mois de septembre de l'an du Seigneur mille quatre
cent
trente-sept ».
Jean
Brulelou, verum est.
Ce 18
septembre 1437, un certain Jean Brulelou mettait
un point final à son manuscrit à Saint-Séglin, commune limitrophe de
Pipriac.
Il se définit comme étant « du diocèse de Saint-Malo ». Cette référence
a une
structure non pas géographique mais ecclésiastique et reprend les
informations
qu'il a données à la page précédente.
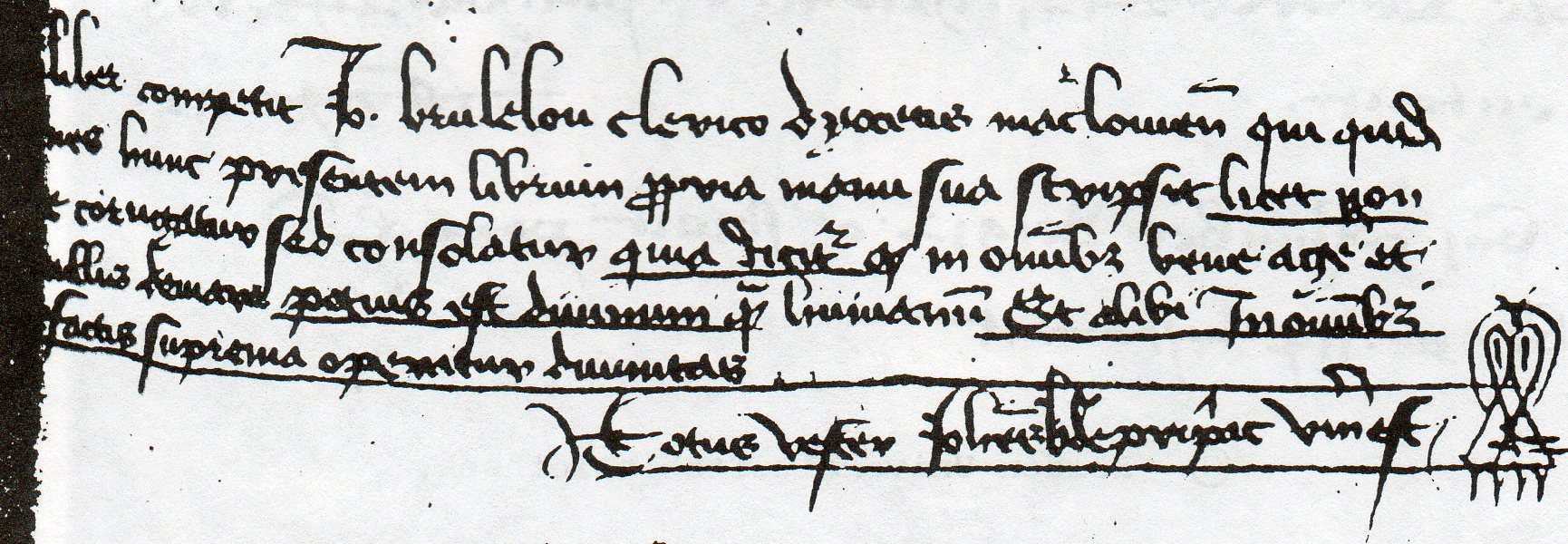
©
Leiden
Universiteitsbibliotheek
C'est-à-dire :
« Ce livre appartient à Jean
Brulelou, clerc du diocèse de Saint-Malo, lequel Jean a écrit de sa
propre
main le présent livre ». Même s’il n'est pas bien corrigé, l'auteur
se
console en se disant que bien agir en toutes circonstances sans jamais
faire
d'erreur relève davantage de Dieu que de l'homme. Et, d'autre part,
dans toute
chose bien faite, c'est la divinité suprême qui est à l'œuvre.
Tout
à vous : Jean B. de Priperac, verum
est. »
Ce
texte apporte davantage de précisions sur l'auteur.
Jean Brulelou est clerc. Il appartient au diocèse de Saint-Malo dont
font
partie les paroisses voisines de Pipriac et de Saint-Séglin. Ses
commentaires
portent l'empreinte d'une culture religieuse évidente. Brulelou est
également
copiste. Avec insistance, il s'attribue ce manuscrit « écrit de sa
propre main
». Il se réfère aussi à un usage de l'époque : son livre n'est pas
exempt de
fautes, ce qui confirme indirectement ses talents de copiste.
Sa
signature est claire : Jean Brulelou de Priperac, alias
Pipriac. Même lieu de naissance que Brito... Simple coïncidence ? Il
existe
d'autres points communs entre Brulelou et Brito. Ainsi :
- Ce manuscrit de Leyde vient de Bruges où il
faisait
partie de la bibliothèque de Franciscus Nansius. Or, Brito vécut à
Bruges.
- Sur les trois livres copiés par Brulelou, deux
seront imprimés par Brito à Bruges : le Theodolus et le Caton.
- Sur l'une des pages du manuscrit, on a rajouté
plus
tard, mais de la même écriture, ces lignes :
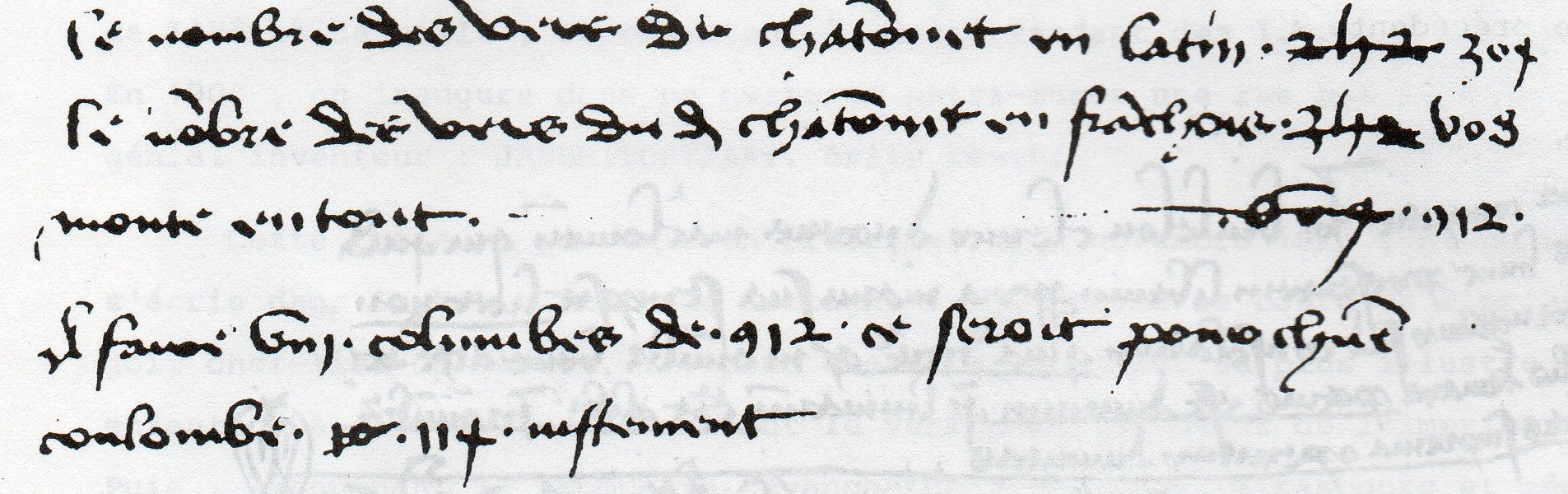
©
Leiden
Universiteitsbibliotheek
« Le
nombre
des vers du chatonnet en latin 304
« Le
nombre des vers du dit chatonnet en franchois 608
«
Monte en tout 912
« À
faire huit colombes de 912 ce seroit pour chaque colombe 114 justement.
»
Ces
notes, utilisant le jargon des imprimeurs, ont
servi à calculer la quantité de papier nécessaire à l'impression de
deux-cents
exemplaires des Disticha Catonis en latin-français.
Brulelou
en a copié le texte latin dans son manuscrit.
Brito l'a bien plus tard imprimé à Bruges. Il en a même fait deux
versions bilingues
: l'une en latin-français (le texte cité est relatif à cette édition),
l'autre
en latin-flamand. Les coïncidences entre Brulelou et Brito sont
trop
nombreuses pour n'être que des coïncidences.
On
peut donc raisonnablement suivre
Pieter Obbema
dans
ses conclusions : BRULELOU =
BRITO.
LES
ANNÉESDE FORMATION
Le
manuscrit de Leyde permet de dater
approximativement la naissance de Brito. Si Brulelou est clerc en 1437,
cela
implique qu'il a au minimum une quinzaine d'années. Il est donc né
avant 1422. Étant
donné la maturité intellectuelle exigée pour la copie d'un tel
manuscrit, la
qualité de la calligraphie, le temps nécessaire à ce travail, Brulelou
devait
avoir une vingtaine d'années en 1437. Il serait donc né vers 1417, plus
certainement entre 1415 et 1420.
Brulelou
est clerc : il a donc reçu une éducation religieuse
et appris le latin, alors langue du culte et de la culture. Au xve siècle, il
n'existe pas
de séminaire dans le diocèse de Saint-Malo ni en Bretagne. Sa formation
intellectuelle et religieuse, Brulelou a pu la recevoir auprès d'un
prêtre des
environs, à Saint-Malo ou même à Paris.
Au
sens strict, le clerc est celui qui a reçu les
ordres mineurs, le tonsuré, qui déjà fait partie du monde
ecclésiastique sans
toutefois avoir rompu avec le monde des laïcs. « Tout un peuple de
tonsurés,
dont la condition demeurait mal définie, formait aux confins des deux
ordres
une marge de couleur indécise », écrit M. Bloch. Situation privilégiée
dont
certains profitent sans vergogne. À l'époque, la cléricature peut
constituer la
voie royale de l'ascension sociale. À condition, bien sûr, d'en sortir.
Au
cours de sa jeunesse, Brulelou a étudié la
calligraphie, l'art de l'écriture manuscrite. À cinq cents mètres du
village de
la Ville-aux-Greniers, sur un axe routier important, se tenait le
manoir du
Frégon. De cette époque subsiste au moins un très beau linteau en
pierre verte
sur laquelle est sculptée une hermine de forme primitive. Ce manoir
appartenait
aux seigneurs de Bossac, famille alors importante en Bretagne. C'est
là,
dit-on, que les actes de la famille de Bossac étaient tenus. Peut-être
la mère
de Brulelou/Brito préparait-elle de l'encre pour les scribes
de ce manoir? Peut-être Brulelou y a-t-il travaillé ou du moins
appris la calligraphie?
De
1437 à 1446 : le virage
Après
1437, on perd sa trace jusqu'en 1446 où on pense
la retrouver à Tournai. Que s'est-il passé pendant cette période? On en
est
réduit aux hypothèses en l'absence de tout document. Une certitude
cependant :
un changement important intervient dans la vie de Brito. Il va quitter
la Bretagne.
Il va aussi quitter la voie ecclésiastique, vraisemblablement pour se
consacrer
à l'écrit.
A-t-il
été contraint, à la suite d'une sombre affaire,
de quitter son pays? A-t-il senti que la situation politique en
Bretagne allait
s'assombrir? A-t-il voulu changer de vie, tenter sa chance ailleurs?
A-t-il
suivi quelqu'un? Pour l'instant, les causes de son départ nous sont
totalement
inconnues.
Contrairement
à ce qu'on peut imaginer, les voyages ne
sont pas rares au xve siècle. Les artistes sillonnent
l'Europe,
passant d'une cour à l'autre. Les autres aussi se déplacent pour fuir,
pour
travailler, pour se rendre à un pèlerinage. Par exemple, cet Étienne
Pillet,
originaire lui aussi du diocèse de Saint-Malo : après ses études de
théologie à
Paris, il prêchera notamment à Metz et à Mayence. Sa fougue lui valut
le surnom
de Brulefer.
Un
Breton qui va en Flandre à cette époque, cela n'a
rien d'exceptionnel. Le trajet se fait régulièrement, par terre ou par
mer. «
La marine commerciale bretonne ... devient l'un des éléments majeurs du
commerce nord-sud de l'Europe de l'Ouest ». La France voit d'ailleurs
d'un
mauvais œil cette activité maritime qui s'exerce à son détriment. Les
relations
commerciales entre Bretagne et Flandre sont relativement intenses.
Témoin
l'activité de ce marchand de Vitré : « André Bernardin, membre de la
Confrérie
de l'Annonciation, est l'un des plus riches marchands de Vitré. Il se
rend
quatre fois par an en Flandres : aux foires de Bruges, de Bergues et
d'Anvers
où il vend des cargaisons entières de « quenevez », ces canevas qu'on
fabrique
à Vitré, Noyal, Tinténiac et Bécherel. Ses confrères et lui en retirent
des
bénéfices plus qu'appréciables... En 1473, les marchands vitréens
rapportent
des Flandres un tableau signé Jean Capman, des tapisseries, de la soie
verte,
des vitraux ».
Par
terre ou
par mer, Brulelou quitte la Bretagne. Il n'y reviendra sans doute plus.
TOURNAI
: JEHAN LE BRETON
En
1446, habite à Tournai un certain Jean Le Breton
que les spécialistes identifient à Brito. Deux documents au moins les y
autorisent.
Le 27
août 1446, « Maistre Jehan Le Borton, maistre
de la Escripture, Tournai » gagne un lot à la Loterie de Bruges. Il
avait
le numéro 397.
©
Archives Municipales de Bruges
Deux
ans plus tard, le 28 juin 1448, un certain
Périnet de La Marche, natif de Rouen, teinturier sur soie à Tournai,
signe une
reconnaissance de dette envers un «Jehan Le Borton, escripvans, né
de
Bretaigne». Il lui devait 3,25 saluts d'or. Ce document des
Archives de
Tournai fut détruit lors des bombardements de la Seconde Guerre
mondiale. Il
est cependant attesté dans plusieurs ouvrages antérieurs.
Même
nom, même profession : il s'agirait dans ces deux
textes de la même personne. Tout porte à croire qu'il s'agit en fait de
Brito :
comme lui, ce Jehan Le Breton travaille dans la calligraphie, comme lui
il
vient de Bretagne. Et Tournai ne se trouve qu'à quatre vingt kilomètres
de
Bruges où vivra Brito.
Notons
qu'il a changé d'identité. Changer de nom en
changeant de pays, sans oublier ses origines, est un phénomène courant
: on
trouve bien des Langlais, des Lallemand et même des Lebreton... en
Bretagne.
Désormais, son nom (où plutôt son surnom) marquera sa provenance : Le
Breton, Bortoen
et Brito signifient « originaire de Bretagne ».
Le
registre des Loteries de Bruges présente Brito
d'une façon redondante en lui attribuant par deux fois le titre de
Maître en
une seule ligne.
«
Maistre Jehan Le Borton» : le titre semble
inséparable du nom et témoigne d'une considération évidente envers
l'homme qui
le porte.
«
Maistre de la escripture» : l'énoncé de la
profession est beaucoup plus précis que dans la reconnaissance de dette
(escripvans). Il implique une qualification poussée dans le domaine de
la
calligraphie. Le Breton n'est pas un apprenti, mais un copiste
professionnel,
un maître-calligraphe. Brulelou s'est donc installé comme calligraphe à
Tournai, centre intellectuel et artistique important que l'histoire a
situé
tantôt en France, tantôt en Flandre. Un peu plus au nord se trouve la
capitale,
Bruges. Jehan Le Breton s'y est déjà rendu en 1446. Il aura l'occasion
d'y
retourner et d'y résider longtemps.
Bruges au XV siècle Jan Brulelou de Pipriac =Jan Brito=Jan Le Breton Jan Bortoen Colophon Sa pierre tombale Son portrait |
